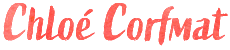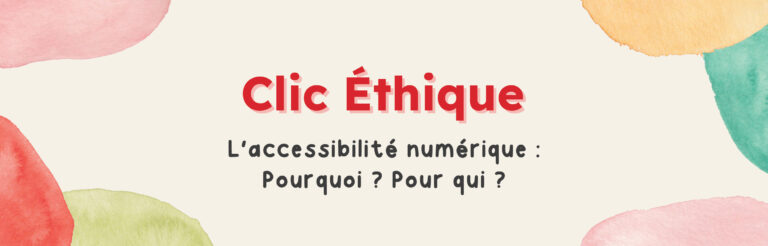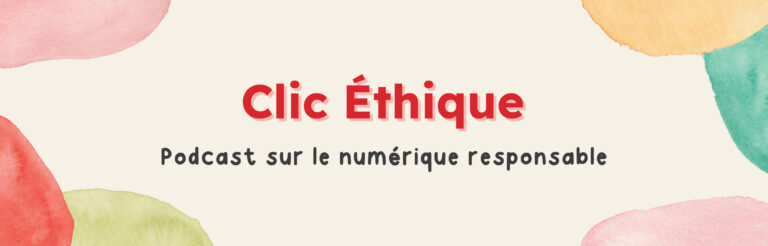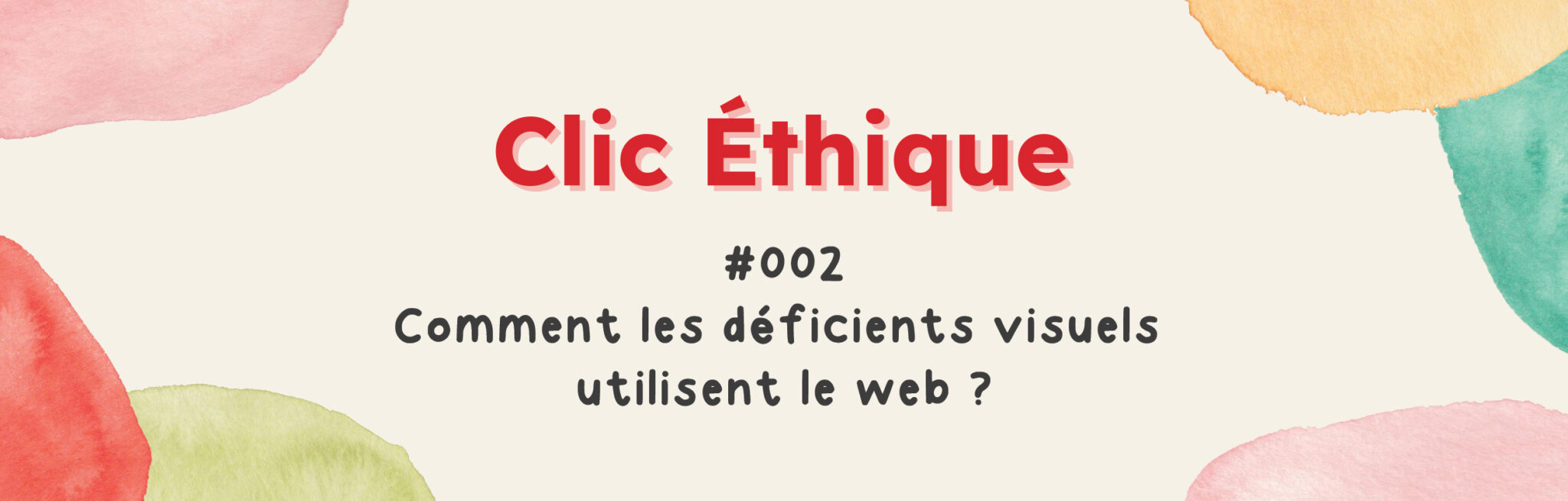
Comment les déficients visuels utilisent le web ? – Podcast Clic Éthique
-

Écrit par Chloé Corfmat
-
Écrit le
-
Lecture 9 min.
Je suis très heureuse de vous présenter le second épisode de mon podcast Clic Éthique : « Comment les déficients visuels utilisent le web ? »
Dans l’épisode, j’aborde :
- Ce qu’est le handicap visuel ?
- Comment les déficients visuels naviguent sur le web ?
- Quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent ?
Cet épisode vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les difficultés rencontrés au quotidien par les personnes aveugles ou malvoyantes. ✨
Vous trouverez ci-dessous la transcription textuelle de l’épisode.
Je vous souhaite une bonne écoute, à bientôt ! 😊
Transcription textuelle
Introduction
Bonjour et bienvenue dans Clic Éthique, le podcast où l’on explore les enjeux environnementaux et sociaux du numérique pour un Web plus responsable. Je suis Chloé Corfmat, développeuse Web et consultante en accessibilité numérique, free-lance. Au quotidien, j’aide mes clients à concevoir et à mettre en place des services numériques plus éthiques. Dans chaque épisode, je vous accompagne et vous guide pour que nous adoptions ensemble des pratiques plus responsables, durables et inclusives. Vous retrouverez sur mon blog chloecorfmat.fr, la retranscription textuelle de cet épisode ainsi que de toutes les ressources dont je me suis servie pour le préparer et dont je parle dans le podcast. Bonne écoute !
Dans le premier épisode de Clic Éthique, nous avons vu que l’accessibilité du Web permettait aux personnes handicapées d’utiliser le Web. Concrètement, ça veut dire qu’elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec, mais aussi y contribuer.
Mais au fait, qu’est-ce qu’un « handicap » ?
D’un point de vue légal, la définition se trouve dans l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles. Un handicap est une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, causée par (au moins) une altération physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique.
Autrement dit, une personne est en situation de handicap lorsque son environnement ne s’adapte pas à ses capacités. Ce n’est pas la déficience en elle-même qui pose problème, mais bien l’absence d’aménagements adéquats.
Certains handicaps, comme les déficiences visuelles, peuvent fortement impacter la façon dont une personne utilise le Web… et c’est là que l’accessibilité numérique prend tout son sens.
C’est quoi une déficience visuelle ?
En France, près de 2 millions de personnes sont atteintes d’un trouble de la vision (Fédération des Aveugles de France). Mais toutes ne sont pas totalement aveugles : la grande majorité perçoit encore partiellement son environnement.
La malvoyance désigne une déficience visuelle significative, mais qui laisse une certaine capacité de vision. À l’inverse, une personne aveugle n’a aucune perception visuelle.
D’après l’AGEFIPH, on parle de déficience visuelle lorsque l’acuité est inférieure à 3/10. Mais la vision peut être altérée de différentes manières :
- une acuité visuelle réduite comme une forte myopie
- des difficultés de perception des couleurs et des contrastes comme le daltonisme
- une réduction du champ visuel due à des maladies comme la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) ou la rétinite pigmentaire
La cécité, elle aussi, varie d’une personne à l’autre. Certaines perçoivent encore des formes ou des sources lumineuses, tandis que d’autres n’ont plus aucune perception visuelle.
Les personnes aveugles ne représentent que 13 % des déficients visuels. La majorité d’entre eux perçoivent encore partiellement leur environnement, ce qui influence directement leur manière d’utiliser le Web.
Comment les aveugles et malvoyants utilisent le web ?
Aujourd’hui, le Web est un outil incontournable de notre quotidien. Nous l’utilisons pour nous divertir, avec les livres audio, les séries, les films ou les jeux vidéo. Il nous permet aussi d’effectuer des démarches administratives, comme déclarer nos impôts ou demander des allocations. Grâce à lui, nous pouvons faire nos courses, commander un repas ou acheter un produit en quelques clics. Il nous permet aussi d’accéder à l’actualité ou à des informations sur des thématiques très variées grâce aux journaux et encyclopédie en ligne. Enfin, grâce à lui, on peut maintenir le lien social, via les réseaux sociaux, les messageries et les applications de rencontre.
Pour les personnes en situation de handicap, ces usages représentent bien plus qu’un simple confort : ils leur permettent de gagner en autonomie.
Mais accéder à ces services n’est pas toujours simple. En près de 40 ans, le Web a évolué. Les pages sont devenues plus complexes, intégrant images, vidéos, graphiques et tableaux. Si ces avancées améliorent l’expérience pour beaucoup, elles créent aussi de nouveaux obstacles, notamment pour les personnes déficientes visuelles.
D’après une étude menée par l’association Valentin Haüy, 88 % des déficients visuels interrogés utilisent un ordinateur ou un téléphone portable au quotidien. Parmi eux, 83 % estiment que les nouvelles technologies leur facilitent la vie et les rendent plus autonomes.
Pourtant, une réalité demeure : moins de 10 % des sites Web leur sont accessibles.
L’étude de l’agence Lunaweb
L’accessibilité du Web n’est pas qu’une question de confort, c’est un enjeu d’égalité. Mais concrètement, quel impact a un site non accessible sur l’expérience des utilisateurs déficients visuels ?
En 2023, l’agence Lunaweb a réalisé une étude sur l’accessibilité web et le handicap visuel. Son équipe a réalisé des tests utilisateurs avec des personnes aveugles, malvoyantes et voyantes. L’objectif ? Comparer le temps nécessaire à chacun pour effectuer une même tâche sur un site Web.
Les résultats sont édifiants :
- Une personne sans déficience visuelle a complété la tâche en moins de 5 minutes (4 min 53 s).
- Une personne malvoyante y a consacré trois fois plus de temps, soit 13 minutes en moyenne (13 min 07 s).
- Une personne aveugle, elle, a mis près de 43 minutes (42 min 46 s), soit 9 fois plus de temps qu’un utilisateur voyant.
Ces chiffres illustrent une réalité simple : plus un site est inaccessible, plus il devient chronophage – voire impossible à utiliser – pour les personnes déficientes visuelles.
Les technologies d’assistance
L’étude de Lunaweb l’a montré : un site non accessible peut considérablement allonger le temps nécessaire pour effectuer une tâche simple. Mais heureusement, des solutions existent pour faciliter la navigation des personnes déficientes visuelles.
Ces utilisateurs s’appuient sur des technologies d’assistance, qui leur permettent d’interagir avec les sites web autrement que par la vue. L’une des premières contraintes ? L’impossibilité d’utiliser une souris, car suivre un pointeur sur un écran nécessite une bonne vue.
Certaines technologies d’assistance sont des logiciels directement installés sur l’ordinateur ou le téléphone de l’utilisateur :
- Les loupes d’écran permettent aux utilisateurs de configurer l’affichage des sites web pour améliorer leur lisibilité : agrandir le contenu, modifier les couleurs ou la police de caractères…
- Les synthèses vocales lisent à haute voix les textes et contenus, mais expliquent aussi l’interface à l’utilisateur. Parmi les plus connus, on retrouve JAWS et NVDA sous Windows, VoiceOver sur Mac et iPhone, ou encore TalkBack sur Android.
D’autres technologies prennent une forme plus tangible :
- Les plages braille affichent en temps réel une transcription en braille du texte présent à l’écran.
- Les guides-doigts aident à mieux utiliser un clavier en empêchant les frappes involontaires – un outil utile aussi bien pour les personnes aveugles que pour celles ayant un handicap moteur.
Mais pour que ces outils fonctionnent efficacement, encore faut-il que les sites soient compatibles avec eux !
Le W3C, l’organisme qui définit les standards du Web, référence les recommandations pour assurer cette compatibilité.
Un site bien conçu doit respecter ces règles afin que tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation, puissent y accéder sans obstacle.
10 problèmes récurrents pour les déficients visuels
Les utilisateurs atteints d’un handicap visuel rencontrent des obstacles spécifiques lorsqu’ils naviguent sur le web. Ces problèmes sont souvent récurrents et, si ils ne sont pas pris en compte, peuvent rendre l’expérience en ligne frustrante, voire inaccessible. Voici les dix difficultés les plus courantes que ces utilisateurs rencontrent.
Les personnes malvoyantes utilisent fréquemment des logiciels qui modifient l’apparence des textes pour les adapter à leurs besoins spécifiques. Cela inclut le zoom, le changement de la police de caractères ou des couleurs de l’interface (fond et texte). Il est essentiel que le contenu reste lisible et compréhensible, même après ces ajustements. Par exemple, les textes ne doivent pas se superposer ou être masqués par d’autres éléments de la page, car cela pourrait rendre l’information inaccessible.
De nombreuses personnes malvoyantes ont des difficultés à percevoir les couleurs de manière distincte. Pour qu’elles puissent comprendre correctement le contenu d’une page web, il est crucial que les couleurs soient suffisamment contrastées. Des outils en ligne comme Tanaguru Contrast Finder permettent de vérifier et d’ajuster le contraste entre le texte et son arrière-plan pour garantir une meilleure lisibilité.
Un site web est construit grâce à des balises HTML, qui décrivent et organisent le contenu : titres, listes, citations, tableaux, etc. Ces balises sont interprétées par les technologies d’assistance, ce qui permet à l’utilisateur de naviguer plus facilement. Par exemple, un utilisateur peut sauter d’un titre à l’autre ou accéder directement au contenu principal sans se perdre dans les éléments secondaires.
Les personnes déficientes visuelles ne peuvent pas utiliser une souris pour naviguer. Elles utilisent donc un clavier pour interagir avec tous les éléments de la page. Il est primordial que tous les éléments interactifs (liens, boutons, champs de formulaire) soient accessibles au clavier et dans un ordre logique. Par exemple, un utilisateur doit pouvoir naviguer de manière fluide à travers les liens d’un menu de navigation, ou à l’intérieur d’une fenêtre modale.
Lorsqu’un utilisateur interagit avec un bouton ou un lien, il doit pouvoir anticiper ce qui va se produire : changera-t-il de page ? Sera-t-il redirigé vers un autre site ? Une nouvelle fenêtre va-t-elle s’ouvrir ? Les intitulés des éléments interactifs doivent être clairs et explicites, afin que les utilisateurs sachent à quoi s’attendre avant de cliquer.
L’utilisation des émojis est courante sur le web, notamment sur les réseaux sociaux. Cependant, tous les émojis ont une signification précise qui est utilisée par les lecteurs d’écran. Si un émoji est mal utilisé, cela peut prêter à confusion et rendre la lecture difficile, voire incompréhensible. Par exemple, l’émoji représentant trois gouttes d’eau 💦 est parfois utilisé pour signifier de l’eau, mais il représente en réalité des « gouttes de sueur ». Un mauvais usage des émojis peut créer des malentendus pour les utilisateurs déficients visuels.
Les déficients visuels ne peuvent pas voir les images, et il est donc essentiel de fournir des descriptions textuelles pour toutes les images porteuses d’informations. Ces descriptions doivent être insérées dans l’attribut ALT de l’image afin que les technologies d’assistance puissent les lire et transmettre le message de manière appropriée.
Les vidéos, comme les films, documentaires ou séries, contiennent des informations visuelles importantes. Or, ces informations échappent aux personnes aveugles ou malvoyantes. Afin de les rendre accessibles, il est crucial d’ajouter des transcriptions textuelles ou des audiodescriptions pour décrire ce qu’il se passe à l’écran aux utilisateurs.
Une personne utilise le web pour réaliser une action précise : remplir une démarche administrative, acheter un produit, s’informer, etc. Les utilisateurs déficients visuels doivent pouvoir accomplir ces actions comme tous les autres utilisateurs. Pour cela, tous les composants riches, comme les modales, les systèmes d’onglets ou les méga menus, doivent être compatibles avec les technologies d’assistance. Cela permet d’assurer une navigation fluide et fonctionnelle, que ce soit avec des synthèses vocales ou des plages braille.
Les CAPTCHA sont souvent utilisés après un formulaire pour vérifier qu’un utilisateur est un humain et non un robot. Ils consistent généralement à reconnaître des lettres, des chiffres ou des images. Cependant, ces tests sont rarement compatibles avec les technologies d’assistance, ce qui les rend difficilement accessibles pour les personnes déficientes visuelles. Il est donc important de s’assurer que le CAPTCHA soit accessible, ou bien d’offrir une alternative accessible, pour ne pas exclure ces utilisateurs.
Ces dix problèmes sont loin d’être exhaustifs, mais ils soulignent bien les principaux défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes d’un handicap visuel lors de leur navigation sur le web. Il est crucial que les professionnels du web intègrent ces éléments dans leur processus de création pour garantir une expérience en ligne inclusive.
Conclusion
Grâce au web, les personnes déficientes visuelles peuvent gagner en autonomie, mais de nombreux obstacles demeurent, rendant leur expérience en ligne souvent plus lente et complexe.
En tant que professionnels du web – que vous soyez développeur, rédacteur ou encore designer – vous avez un rôle essentiel à jouer pour améliorer l’accessibilité du web. Cela passe par votre propre formation, mais aussi par la sensibilisation de votre réseau et l’adoption des bonnes pratiques dans vos projets futurs.
Un site web accessible à tous est un site web plus inclusif, plus éthique et plus agréable pour chacun de nous.
C’est ce que nous avons cherché à accomplir avec le Portail de l’audiodescription, un projet porté par le Ministère de la Culture que nous co-construisons avec l’équipe projet, et les utilisateurs déficients visuels. La première version du portail a été annoncée le 25 février dernier par Rachida Dati, Ministre de la Culture, en présence de la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ. Ce site référence les films en audiodescription, disponibles auprès de partenaires comme Canal+, Orange, LaCinetek, France TV et Arte, et il continuera d’évoluer pour améliorer l’accès à la culture pour tous.
Merci d’avoir écouté cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon site web. N’hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode !
Prenez soin de vous, à bientôt !
Références
-
Portail de l'audiodescription
Le portail de l’audiodescription fournit aux déficients visuels un accès à un catalogue de films audiodécrits.
https://audiodescription.beta.gouv.fr/